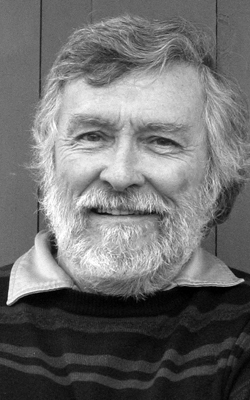Sa spécialité, c’est le polar déjanté, les héros poqués, l’humour noir foncé. Et il affectionne le langage cru, coloré. L’ex-publicitaire sexagénaire a fait paraître récemment deux courts romans loufoques à souhait: l’un où les meurtres se multiplient dans la vie d’un orphelin, Le seul défaut de la neige (XYZ éditeur), l’autre où des motards à gros bras menacent de s’en prendre à un pauvre paumé, Fantasia chez les Plouffe (Éditions La Branche).
1. Pourquoi vous mettez-vous dans la peau de deux ratés?
Parce que j’aime les ratés! Je trouve qu’on leur accorde trop peu d’attention. Je déteste les individus brillants. Je pense par exemple au Da Vinci Code, que j’ai lu lors d’un voyage en Thaïlande. Quelle horreur! Ce livre met en scène des personnages prétentieux qui se croient super intelligents. Ça m’ennuie profondément. Les paumés sont plus attachants: ils savent qu’ils sont des losers, et ont pourtant plein d’espoir, naïvement. Le héros du Seul défaut de la neige s’imagine qu’il arrivera à coucher avec sa tante, et celui de Fantasia chez les Plouffe croit qu’il héritera de son grand-père. Mais quand ça ne se produit pas, ils ne sont pas particulièrement surpris.
2. Vous parsemez vos textes d’expressions populaires. Pourquoi?
Je cherche toujours une manière d’écrire qui correspond à la manière de parler de mes personnages. Ça m’évite d’avoir à faire de belles phrases.
3. Vos deux romans se passent dans de petits villages du Québec. Mais vous saviez que Fantasia chez les Plouffe serait publié en France. Cela a-t-il influencé votre manière d’écrire?
J’ai voulu éviter que les Québécois me voient arriver avec mes gros sabots, mais je n’ai pas utilisé «d’ultra joual» dans les dialogues, parce que les Français doivent avoir l’impression de tout comprendre: ils détestent que quelque chose leur échappe. Ça n’est pas grave si certains trucs leur passent au-dessus de la tête; l’important, c’est qu’ils croient qu’ils ont tout saisi.
L’extrait
Les écureuils de Central Park sont tristes le lundi
Katherine Pancol (Albin Michel)
Ce n’est pas pour rien qu’on parle en France de «pancolmania». Les deux premiers tomes de la saga romantique de l’auteure, Les yeux jaunes des crocodiles et La valse lente des tortues, se sont vendus à deux millions d’exemplaires. Le troisième pavé, paru au printemps dernier, devrait connaître le même succès. C’est avec bonheur qu’on renoue, dans Les écureuils de Central Park sont tristes le lundi, avec les personnages auxquels on s’était attachées. Leur quête du bonheur se poursuit. Et, bien sûr, il y a de l’amour dans l’air… comme en témoigne la scène qui se passe pendant un concert au Royal Albert Hall de Londres.
«C’est alors que…
Ils s’aperçurent au détour d’un couloir.
S’arrêtèrent, saisis par la surprise. […] Ils restèrent immobiles sous la lumière des lustres en cristal du grand hall. Comme deux inconnus. Deux inconnus qui se connaissent, mais ne doivent pas se rencontrer.
Pas s’approcher. Pas se toucher.
Ils le savaient. La même phrase dictée par la raison, la même phrase cent fois répétée tournait en gyrophare dans leur tête.
Et leur donnait un air de mannequin, un peu raide, un peu stupide, un peu emprunté.
Tout ce qu’il voulait à ce moment précis, tout ce qu’elle réclamait en hurlant de silence, c’était tendre, tendre la main et toucher l’autre.
Ils étaient face à face.
Philippe et Joséphine.»

À LIRE: Trois romans qui revisitent l’histoire