Société
Misogynie médicale: quand nos douleurs ne sont pas prises au sérieux
Le sexisme – et tout ce qui a trait aux douleurs féminines inexpliquées – est au cœur de la longue histoire de la gynécologie. Et on en ressent encore les contrecoups aujourd’hui.
par : Caitlin Stall-Paquet adapté par Elisabeth Massicolli- 09 août 2022

Lawrence Fafard
J’ai dû me faire poser un stérilet deux fois plutôt qu’une. Par mégarde, j’avais retiré le dispositif en cuivre en enlevant ma coupe menstruelle sous la douche. J’étais horrifiée. Lorsque la gynécologue l’a remis en place en dilatant manuellement le col de mon utérus (une pratique courante lors de la pose d’un stérilet chez les femmes qui n’ont pas accouché), une douleur profonde, que je n’avais jamais ressentie auparavant, m’a traversé le bassin. Pour ne pas que j’aie à revivre ce moment douloureux de sitôt, la gynécologue a entièrement coupé le fil de mon appareil, réduisant ainsi le risque qu’il soit retiré accidentellement. Puis, elle m’a rassurée, elle a été bienveillante. Cinq ans plus tard, j’étais de retour en gynécologie pour remplacer mon stérilet, et le souvenir de ma souffrance a fait monter mon niveau de stress en flèche. Quand je suis entrée dans la salle d’examen, j’ai tout de suite voulu aborder le sujet de mes précédentes complications liées au stérilet avec le médecin de garde – un homme, cette fois-ci. Les yeux encore rivés sur de la paperasse, il m’a répondu en levant la main, sans mot dire, pour m’indiquer d’arrêter de parler. Ce n’est que lorsqu’il a inséré le spéculum qu’il a semblé prêter attention à ma situation, et m’a demandé, sur un ton accusateur, pourquoi mon stérilet n’avait pas de fil. Il semblait contrarié de devoir, de ce fait, dilater le col de mon utérus. J’étais embarrassée et franchement inconfortable. Les pieds dans les étriers, serrant les dents pour oublier l’élancement dans mon bas-ventre, je me suis dit que je me serais sentie vraiment mieux s’il avait pris la peine de m’écouter.
De génération en génération
Les lancinantes douleurs dans les jambes dont souffrait l’historienne en culture féministe et autrice Elinor Cleghorn ont été ignorées pendant 10 ans. On lui disait qu’elle était «hormonale» et on remettait systématiquement en question ses symptômes. Puis, un jour, le diagnostic est tombé: elle était atteinte d’un lupus. La maladie d’Elinor a atteint son paroxysme lorsqu’elle était enceinte de son deuxième fils et que les médecins ont découvert une irrégularité cardiaque in utero liée à sa propre maladie. Bien qu’elle soit reconnaissante pour les soins qui ont été prodigués à son fils, cette situation l’a amenée à se demander pourquoi sa douleur n’avait pas été prise au sérieux avant que son corps remplisse sa soi-disant fonction biologique. «J’étais soudainement digne de soins, j’étais soudainement une priorité», dit-elle. Cette expérience l’a poussée à se plonger dans l’histoire de la misogynie médicale, et à écrire Unwell Women, publié au printemps dernier, qui montre à quel point le sexisme est ancré dans le domaine médical – et comment il est la pierre angulaire de la gynécologie telle qu’on la connaît.
Dans son livre, Elinor nomme une foule d’idées absurdes qui ont été véhiculées au fil du temps. Dans la Grèce antique, on croyait que l’utérus «errait» dans la cavité pelvienne s’il était inutilisé; au Moyen Âge, le traité Secrets des femmes propageait des mythes sur la conception et l’anatomie féminine; dans l’Angleterre victorienne est apparu le diagnostic d’hystérie (un mot dérivé du mot grec signifiant «utérus»), considéré comme un trouble du système nerveux résultant des émotions «excessives» des femmes. L’incompréhension, la désinformation et la méfiance à l’égard du corps féminin se transmettent depuis des siècles, de génération en génération.
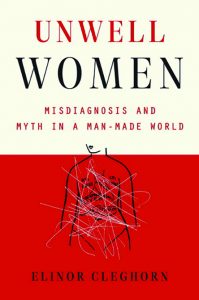
L’ouvrage Unwell Women par Elinor Cleghorn.
Endurer la souffrance
Le concept d’«hystérie», par exemple, a traversé les âges, et on en ressent encore les contrecoups dans les diagnostics que reçoivent les femmes aujourd’hui. Bien que le diagnostic d’hystérie lui-même ait disparu, il se cache encore derrière d’autres termes utilisés pour diminuer – ou ignorer – les douleurs féminines. Entre autres, le mot «hormonal», qu’on utilise pour expliquer une tonne de symptômes sans investiguer davantage. Cet amalgame de longue date entre l’état émotionnel et psychologique des femmes et leur santé physique fait en sorte que les malaises qu’elles éprouvent ne sont souvent pas pris au sérieux. Une étude publiée dans The Journal of Pain en mars dernier a révélé que, lorsqu’on montrait à des observateurs des images d’hommes et de femmes en souffrance, ils estimaient que la douleur des femmes était moins intense et étaient portés à leur recommander une psychothérapie plutôt que des médicaments.
Il peut être difficile d’analyser l’origine de ces préjugés, mais le problème vient en partie du fait que, jusqu’au 19e siècle, les femmes n’étaient pas admises dans les facultés de médecine de nombreux pays, ce qui avait un effet direct sur ce qui était considéré comme «digne» de recherche. Aujourd’hui, pour la première fois de l’histoire, les femmes sont plus nombreuses que les hommes à être admises en médecine aux États-Unis (au Québec, en 2018, on comptait 63 % de femmes et 37 % d’hommes inscrits en médecine), mais il reste à voir dans quelle mesure la diversité dans les rangs des futurs médecins peut changer les pratiques sexistes systémiques. Elinor Cleghorn raconte qu’elle a subi une grave déchirure pendant son accouchement et que sa médecin lui a fait ce qu’on appelle communément «le point du mari». Elle lui a dit: «Ne t’inquiète pas, je t’ai remis ça bien serré!» L’autrice et historienne se rappelle qu’à l’époque, elle n’avait pas tellement prêté attention à ces mots, mais que, plus tard, en y réfléchissant, elle est restée bouche bée devant ce sexisme manifeste. Non seulement ce point de suture supplémentaire est souvent fait à l’insu de la patiente, mais il peut également entraîner des complications, comme des infections ou des rapports sexuels douloureux.
Le manque de prise en compte de la douleur des femmes signifie qu’elles doivent lutter pour obtenir un diagnostic, tout en endurant leur souffrance. «Elles doivent devenir leur propre défenderesse, être ultra-informées et insister pour obtenir des soins, dit Katelyn Luciani, directrice générale de l’organisme de bienfaisance The Endometriosis Network Canada. C’est la seule façon pour elles d’avoir l’aide dont elles ont besoin.» Ce réseau canadien s’efforce d’apporter un soutien aux personnes atteintes d’endométriose, et de combattre les mythes répandus et la désinformation entourant cette maladie – notamment le traitement suggéré… qui est la grossesse! On parle d’endométriose lorsque des tissus semblables à la muqueuse de l’utérus (l’endomètre) s’implantent ailleurs dans l’organisme, provoquant des lésions, des kystes et des excroissances souvent accompagnés de douleurs débilitantes. Bien que les changements hormonaux liés à la gestation puissent stabiliser les symptômes, la grossesse n’est pas une solution éprouvée à long terme. Et on doit se rappeler que certaines femmes ne peuvent pas – ou ne veulent pas – avoir d’enfants.
L'autrice Elinor Cleghorn
 Lara Downie
Lara DownieDans son ouvrage, Elinor Cleghorn décrit le travail du gynécologue américain Joseph Vincent Meigs. Dans les années 1940, celui-ci affirmait que l’endométriose était une maladie liée à des menstruations trop fréquentes, et qu’à moins que les femmes ne veuillent devenir «anormales», elles devaient «procréer aussi vite et aussi souvent que possible». Cette conclusion rejetait la responsabilité de la maladie sur les patientes, au lieu de chercher de véritables solutions – ce qui n’est pas sans rappeler certains conseils médicaux actuels liés à cette maladie. Le Dr Meigs a aussi faussement caractérisé l’endométriose comme étant le lot des femmes blanches et des classes moyennes ou supérieures, un préjugé qui teinte encore aujourd’hui les diagnostics et l’éducation au sujet de cette maladie. Le caractère raciste et classiste de la théorie du Dr Meigs est indissociable de l’histoire de la gynécologie. Le spéculum, par exemple, a été mis au point à partir d’expériences menées sur des esclaves noires, sans leur consentement, évidemment, et sans anesthésie.
L’organisme The Endometriosis Network Canada estime qu’une étape essentielle pour aider les personnes atteintes d’endométriose consiste à sensibiliser le public à cette maladie. L’un des objectifs de l’organisme est de faire connaître quels en sont les signes révélateurs, qui se manifestent souvent à la puberté, amorçant un cycle infernal qui peut éloigner les malades de la prospérité socioéconomique d’innombrables façons. Les adolescentes atteintes d’endométriose sont 10 fois plus susceptibles de manquer l’école à cause de crampes intenses, de douleurs au dos et des vomissements. Katelyn Luciani est elle-même atteinte d’endométriose et elle a été obligée de quitter son emploi à cause de douleurs trop vives. Elle estime qu’il faut environ cinq ans aux personnes souffrant d’endométriose pour obtenir un diagnostic au Canada, mais ce délai est souvent plus long. La maladie touche une Canadienne sur 10, et un pourcentage indéterminé de personnes transgenres ou non binaires. Et compte tenu des lacunes dans la recherche sur cette maladie, les chiffres réels sont probablement plus élevés. Bien qu’il existe des preuves écrites de l’existence de l’endométriose datant de l’époque des Égyptiens (vers 1550 av. J.-C.!), nous ne savons toujours pas ce qui cause ce trouble, ni comment le traiter.
Une grande partie des femmes grandissent avec l’idée qu’un jour ou l’autre, leur corps les trahira. Quand on possède un utérus, la douleur est comme un contrat tacite entre nous et notre organisme. Mais c’est une idée dépassée, et la situation doit changer. «Il faut mieux écouter les femmes, dit Elinor Cleghorn. Les traiter comme des êtres humains à part entière dans tous les champs médicaux et surtout les croire lorsqu’elles disent: “J’ai mal”.»
Lire aussi:
L’endométriose, ce mal mystérieux
La «menstrubation» : quand le plaisir diminue les douleurs menstruelles
Contraception masculine: et si les hommes prenaient la pilule?
Infolettre
Abonnez-vous pour ne rien manquer des tendances phares et des dernières actus mode, beauté, célébrités, lifestyle.
À lire

Mode
Nos 11 friperies coup de cœur au Canada
En matière de durabilité, le marché du luxe de seconde main se démarque. Et ça tombe bien parce qu’on trouve, partout au Canada, de jolies boutiques vintage où dénicher des pépites de designer chics et uniques. Tour d’horizon en 11 adresses!
par : Randi Bergman adapté par Elisabeth Massicolli- 24 avr. 2024

Style de vie
Recette de petites carottes rôties à la harissa et à la grenade
Une salade éclatante de couleurs vives et de saveurs.
par : Yotam Ottolenghi- 23 avr. 2024

Beauté
Testé et approuvé: un sérum qui sauve notre peau… pendant qu’on fait dodo!
Pour se réveiller avec une peau plus radieuse que jamais et une mine rafraîchie, peu importe la qualité de notre sommeil.
par : ELLEQuebec.com- 11 avr. 2024




